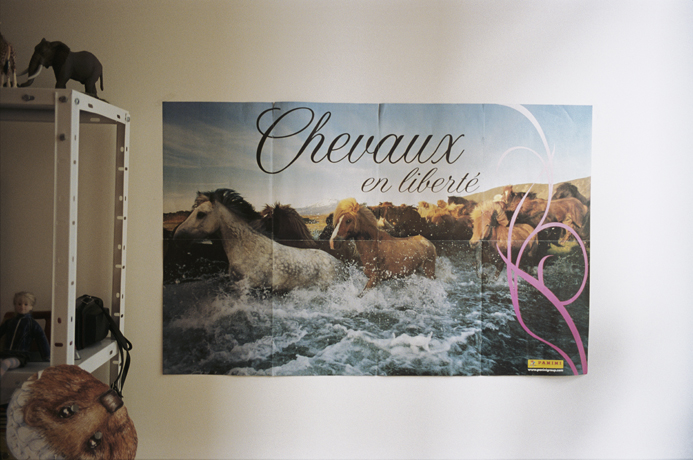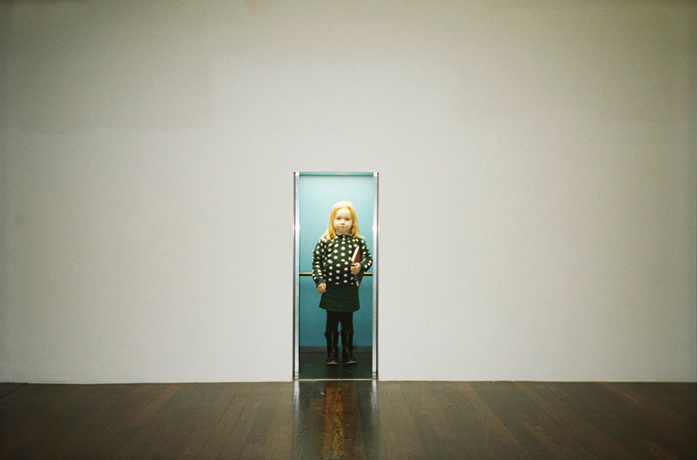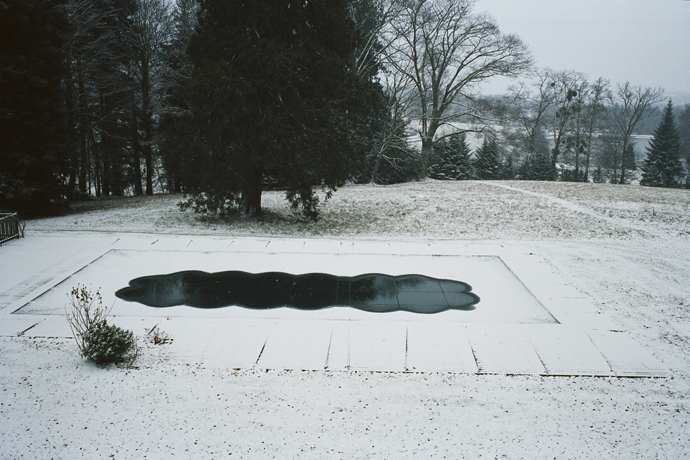Elles veulent déjà s'enfuir.
2010 – 2012.
« Elles veulent déjà s’enfuir », tout est là,
dans ce titre fictionnel et poétique, plantant
le décor d’une histoire en train de se dérouler,
en train de se vivre. Le photographe,
à l’écart, observe les personnages qui peuplent
sa vie intime, ce « elles » si énigmatique tant
il nous emporte dans une histoire peuplée
d’une multiplicité féminine. Il est question
d’une femme et de deux fillettes, mais aussi
d’un amant et d’un père qui voit le temps
s’échapper à travers elles, le temps qui passe,
impossible à saisir si ce n’est par la photographie :
« elle me permet de figer le temps qui agit sur
l’âge de mes enfants, leurs transformations,
de réaliser un travail d’archive au présent ».
Ainsi, ces images ont un statut cinématographique
en ce qu’elles suggèrent une durée, une coupe
temporelle, un instant d’arrêt. Au cinéma, le flux
est bien souvent présent sous la forme du travelling,
et ce n’est pas un hasard si certains paysages qui
ponctuent la série ont été prises depuis la fenêtre
d’une voiture. Mais il ne faudrait pas réduire
ce travail au « ça a été » : plus que d’une
disparation, il s’agirait plutôt d’un disparaître,
d’un évanouissement en acte dans l’ici et
maintenant de la prise de vue. « C’est dans
le présent que j’enregistre de futurs souvenirs »,
précise le photographe qui est alors dans
une position dynamique, combattant peut-être
la nostalgie. Julien Magre se donne des règles
formelles : il privilégie une distance vis-à-vis
de ses sujets, une frontalité, une simplicité
du cadre et du contexte de prise de vue.
Mais, la question de la distance est ici paradoxale :
de même que le petit format des images oblige
le spectateur à se rapprocher, le photographe
ne s’éloigne que pour mieux abolir l’espace
qui le sépare de celles qu’il aime. Souvent,
dans de subtiles chorégraphies, le modèle s’impose
en pied, seul, au centre de l’image. En regardant
l’objectif, la fillette blonde pense à cet homme
derrière un appareil qui décide d’agir sur la réalité
en la contrant, en photographiant, un après
midi d’été, pendant de longues vacances :
la fillette regarde son père, et même si elle ne
le formule pas encore, elle sait que lui aussi veut
s’enfuir, qu’il cherche à créer un monde parallèle
et hors du temps. Brouillant les pistes, la nature
des images est empreinte d’ambiguïté :
les images sont-elles volées ou mises
en scène ? Julien Magre fantasme sa vie,
transfigure le quotidien, mais ce n’est pas
en metteur en scène autoritaire qu’il
créé ses images : c’est bien plutôt en témoin
d’une « scène qui se passe ». Il joue de la frontière
très mince qu’il y a entre la banalité des gestes
et leur possible révélation en instants rêvés.
C’est sans doute ça vivre littérairement sa vie,
vivre toutes choses comme les parcelles
possibles d’un récit qui s’écrirait sous nos yeux,
au bord d’une piscine gelée, dans une baignoire
où le corps flotte, ou face à un paysage
de neige. Restent la trace de visages, reflets
éphémères derrière une vitre, tels des spectres
sérieux ; une danse immobile et silencieuse
au cœur d’une épaisse forêt ; ou un jeu
avec la mort et les fantômes. Ces pantomimes
suggèrent que la vie n’est jamais réductible,
qu’elle est toujours bien plus encore :
à la fois promesse et mystère.
Léa Bismuth,
avril 2013.
Léa Bismuth est critique d’art et
commissaire d’exposition indépendante.
Elle écrit notamment dans Artpress
depuis 2006.